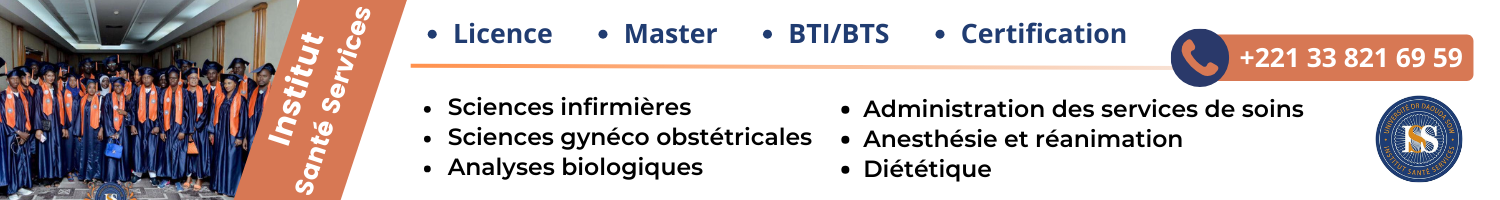Le 07 septembre 1990 disparaissait Youssoupha GNING, Directeur du Département des Services de Santé au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) à la suite d’un accident survenu lors d’une mission à Montréal au Canada. Ce vendredi fut terrible pour toute sa famille, ses amis et particulièrement ses collègues du CESAG car, son assistante de recherche Assitan KONE (qui venait de se marier) y perdit aussi la vie, tandis que deux secrétaires de son département s’en sortirent avec plusieurs séquelles.
Mais qui était Youssoupha GNING ? Voilà un jeune infirmier pour continuer ses études s’embarque au milieu des années 70 pour la France. Et à l’absence d’une bourse comme la plupart des étudiants de l’époque, il se mit à assurer des gardes de nuit dans certains hôpitaux et cliniques, tout en les conciliant avec ses études, ce qui ne l’empêchait pour autant de mener des activités militantes au niveau du mouvement des étudiants de l’époque AESF (Association des Etudiants Sénégalais en France). Après son passage à l’Ecole de Santé Publique de Rennes, et au terme de différents stages, il arriva à occuper un poste de Directeur adjoint à l’hôpital de Villejuif l’un des plus grands hôpitaux de France. De retour au Sénégal vers la fin des années 80, il est nommé Directeur de l’hôpital de Fann où il avait servi comme infirmier.
En 1988, le CESAG qui envisageait de développer pour l’Afrique et la sous-région un programme de formation continue en santé publique en collaboration avec le Département d’Administration de la Santé de l’Université de Montréal (DASUM) fit appel à lui pour faire partie de l’équipe de vacataires devant effectuer un stage d’immersion pédagogique au Canada. A l’issue de ce séjour, Youssoupha en homme entreprenant est arrivé à convaincre ses homologues canadiens à consolider non seulement le programme, mais à décrocher une ligne de financement complémentaire auprès de l’ACDI et de l’ACCT pour en faire un programme diplômant afin de répondre aux besoins des pays africains en matière de déficit d’administrateurs des hôpitaux.
Le Professeur Gilles Dussault à l’époque Directeur du Département d’Administration de la Santé de l’Université de Montréal (DASUM) qui a toujours cru à ce projet n’a ménagé aucun effort pour apporter son soutien. Ainsi, les étudiants des premières promotions du Diplôme Supérieur de Gestion de Santé (DSGS) qui étaient généralement des médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs bio médicaux etc. ont pu bénéficier de bourse ou de prise en charge pour les non sénégalais grâce à ce financement. Toujours dans un souci de permettre à des professionnels ne pouvant pas se déplacer de bénéficier de formations complémentaires, un programme commun d’enseignement à distance avec la technologie de l’époque a été mis en place en collaboration de la Télé-Université du Québec. Il faut rappeler que ce programme commun de formation à distance était le premier au niveau du Département d’Administration de la Santé de l’Université de Montréal.
La coopération inter-universitaire qui s’en ai suivi a permis l’intervention de plusieurs enseignants des universités africaines, européennes, américaines, canadiennes et des experts de l’OMS dans les enseignements au CESAG.
En moins de trois ans, le CESAG était devenu un creuset dans le domaine de la formation et de la recherche sur les questions de santé publique. Plusieurs conventions de recherche dans différents domaines sur les soins de santé primaires, la santé de la reproduction, la planification familiale, la réforme hospitalière etc. furent signés avec plusieurs universités et partenaires (Harvard University, Tulane University, Population Council, Institut Mérieux, JHPIEGO, CRDI, ACCT, etc.). Il faut rappeler qu’à cette époque, les hôpitaux étaient dirigés en général par des administrateurs civils ou dans certains cas par des gradés militaires, pendant que certains précurseurs (Adama KANE à Albert Royer, Lamine Farba SALL au CTO, Falilou DIOP à l’hôpital de Louga etc.) venaient de s’installer. Il faut noter dans cette aventure l’implication forte d’hommes et de femmes (Idrissa DIOP, Dr Bocar DIALLO, Moustapha SAKHO, feu Souleymane SAMAKE, Dr Ngoné Sène TOURE, Ismaila THIOYE, Laurence CODJA, Ibrahima DIOP, Prosper KOFFI, Hélène LOPY, Marie Louise JAMES, Marie Pierre FONSECA, Assitan KONE etc.) qui ont su porter le flambeau pour l’avènement d’une formation endogène en santé publique.
Aujourd’hui, on constate que plusieurs sortants titulaires du Diplôme de Gestion des Services de Santé (DSGS) devenu MBA en Gestion des Services de Santé ont eu à occuper des poste direction de plusieurs hôpitaux au Sénégal et en Afrique. Dans ce sillage, les autorités du CESAG ont pu développer une coopération avec l’Université Paris Dauphine pour mettre en place un diplôme d’économie de la santé (MBA en Economie de la Santé). Les sortants de département occupent actuellement des positions dans les ministères, les projets, l’OMS et dans certaines institutions de développement (BAD Banque Mondiale, BID etc.).
Ce bref rappel permet de cerner la personnalité et la visionJ de cet infatigable combattant pour l’émergence de professionnels en santé publique disparu à l’âge de 36 ans. Et lors de la journée d’hommage et de témoignages, le Professeur Eusèbe ALIHOUNOU du Bénin, doyen honoraire de la Faculté des sciences de la santé, membre de l’Académie Nationale de Médecine de France disait « ce garçon à la trajectoire fulgurante avait une vision panafricaniste du développement de la santé publique ».
Nous retiendrons aussi, quelques semaines après sa disparition, l’Ecole de Santé Publique de Rennes, aujourd’hui Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHEPS) lui rendait hommage en lui donnant le nom de la salle informatique. Quel bel hommage pour un ancien étudiant !
Aujourd’hui, le CESAG est devenu en Afrique et dans le monde une référence en matière de formation en santé publique comme l’atteste certains de ses programmes en santé (Economie de la Santé, Gestion des services de santé etc.). Et c’est l’occasion pour les autorités de cette institution qui certainement ne sont pas au courant du processus de création de ce département, d’ériger particuliérement en exemples voire de modéles des femmes et des hommes qui ont contribué au développement de ce centre car on ne peut durablement contruire une certaine viabilité ou favoriser un sentiment d’appartenance sans capitalisation. L’une des faiblesses majeures de nos organisations en Afrique est l’absence de mémoire institutionnelle.
En ce jour de souvenir et de prières et dans un pays où des individus au parcours douteux sont montés en épingle, le trajet exceptionnel de cet homme qui n’a vécu que 36 ans, mérite d’être conté et de servir de modèle à cette jeunesse en plein désarroi.
Lamine FALL
Consultant
l.fallamadou@gmail.com