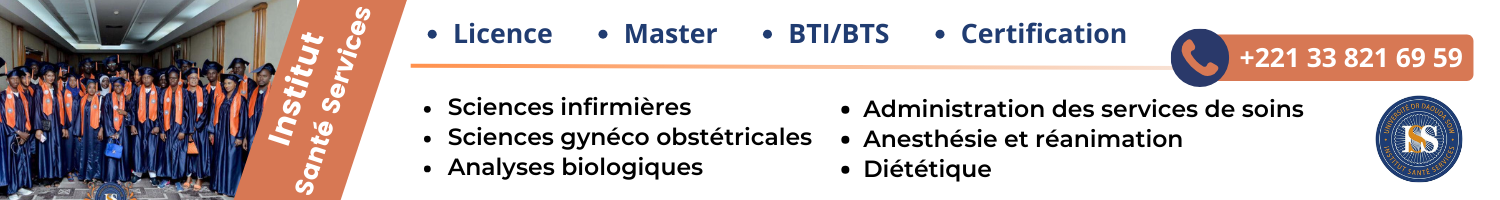Au Sénégal, le paludisme a considérablement reculé ces dernières années, entraînant une baisse notable des cas dans plusieurs régions du pays, y compris dans certaines zones de Dakar. Ce succès est en grande partie attribué aux efforts des institutions de recherche et des structures spécialisées, parmi lesquelles le Laboratoire d’écologie vectorielle et parasitaire (Levp). Installé au sein du département de Biologie animale de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), ce laboratoire joue un rôle clé dans la surveillance, la détection et l’étude des moustiques vecteurs du paludisme à travers le pays. Son travail de recherche et de formation est essentiel pour la mise en place de stratégies efficaces de lutte contre cette maladie endémique.
Un laboratoire au service de la lutte contre le paludisme
Le paludisme reste une des maladies les plus meurtrières au Sénégal, particulièrement en saison des pluies, où la prolifération des moustiques augmente les risques de transmission. Pendant de nombreuses années, cette maladie a causé des ravages importants, affectant des milliers de personnes et entraînant des pertes humaines considérables. Cependant, grâce aux efforts conjugués des chercheurs, du ministère de la Santé et du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), la situation a évolué positivement.
Le Laboratoire d’écologie vectorielle et parasitaire, rattaché à la Faculté des sciences et techniques de l’UCAD, est l’un des piliers de cette lutte. Ce centre d’enseignement et de recherche permet d’identifier les différentes espèces de moustiques responsables de la transmission du paludisme, afin de mieux cibler les interventions. Il joue également un rôle essentiel dans la formation des étudiants et des chercheurs spécialisés en parasitologie et en entomologie médicale.
Une expertise scientifique pointue pour mieux comprendre les vecteurs du paludisme
Le vendredi 27 février, le département de Biologie animale de l’UCAD est en pleine effervescence. Entre les salles de classe et les laboratoires, étudiants et enseignants-chercheurs s’affairent à leurs travaux de recherche. C’est dans cet environnement dynamique que se trouve le Levp, un laboratoire spécialisé dans l’étude des arthropodes vecteurs de maladies et des pathogènes qu’ils transmettent.
Dr Elhadj Amadou Niang, enseignant-chercheur au département de Biologie animale, explique que leurs travaux de recherche portent sur plusieurs maladies vectorielles, notamment le paludisme, les arboviroses, la leishmaniose et l’onchocercose. L’équipe scientifique s’intéresse particulièrement à la biologie des vecteurs, leur génétique, leurs interactions avec les pathogènes et les hôtes vertébrés, ainsi qu’à l’impact des changements environnementaux sur la dynamique des populations de moustiques.
Les recherches menées au sein du laboratoire permettent d’actualiser les données épidémiologiques et d’orienter les stratégies de lutte anti-vectorielle. En fournissant des informations précises sur la distribution des moustiques et leur comportement, le Levp contribue directement à la mise en œuvre d’interventions ciblées et efficaces pour réduire la transmission du paludisme.
Un bras technique du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP)
Le Laboratoire d’écologie vectorielle et parasitaire ne se limite pas à la recherche fondamentale. Il joue également un rôle opérationnel en appuyant le PNLP dans la surveillance des vecteurs et l’évaluation des outils de lutte antipaludique. En tant que laboratoire de référence national, il coordonne plusieurs programmes de surveillance et travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires pour adapter les stratégies de prévention et de contrôle du paludisme.
Dr Niang souligne que le laboratoire est équipé du matériel nécessaire pour analyser les différentes espèces de moustiques présentes au Sénégal et déterminer lesquelles sont responsables de la transmission du paludisme. Il rappelle qu’il existe environ 5 000 espèces de moustiques dans le monde, dont 400 appartenant au genre Anopheles. Parmi ces 400 espèces, seules 60 sont capables de transmettre le paludisme. Grâce aux analyses réalisées au Levp, les chercheurs peuvent identifier ces espèces et étudier leur écologie afin de mieux les combattre.
Un centre de formation pour la nouvelle génération de chercheurs
Au-delà de la recherche, le Levp joue un rôle crucial dans la formation des étudiants et jeunes chercheurs spécialisés en parasitologie et en entomologie médicale. Dr Lassana Konaté, enseignant-chercheur au laboratoire, insiste sur l’importance de la formation dans la lutte contre le paludisme. Selon lui, avant d’envisager l’élimination de la maladie, il est indispensable de comprendre les écosystèmes dans lesquels évoluent les moustiques vecteurs.
Créé en 1994, le laboratoire a été reconnu comme une unité de référence par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui sollicite régulièrement son expertise pour des études sur les vecteurs du paludisme. Depuis, il a formé de nombreux chercheurs qui contribuent aujourd’hui à l’avancement des connaissances scientifiques dans ce domaine.
Parmi les jeunes chercheurs formés au laboratoire, Ndeye Seny Diagne, titulaire d’un Master II, a mené des recherches sur la dynamique des populations d’Anopheles dans les régions de Tambacounda, Kédougou et Fatick. Elle estime que le laboratoire constitue un socle essentiel pour approfondir les connaissances sur le paludisme et espère qu’avec les avancées de la recherche, la maladie pourra un jour être éradiquée du Sénégal.
Moussa Diop, doctorant au Levp, s’est quant à lui spécialisé dans l’étude de l’Anopheles gambiae, une espèce particulièrement impliquée dans la transmission du paludisme dans la région sud du pays. Grâce aux infrastructures et aux ressources mises à sa disposition, il a pu mener des travaux de recherche approfondis sur ce moustique. Toutefois, il souligne la nécessité pour l’État d’accroître son soutien aux chercheurs et de renforcer l’équipement du laboratoire.
Un laboratoire aux ressources limitées
Le Levp est composé de plusieurs unités de recherche, chacune ayant une fonction spécifique dans l’étude et la surveillance des moustiques vecteurs. Cependant, malgré son rôle crucial dans la lutte contre le paludisme, il fait face à des défis de financement et de logistique.
Actuellement, une grande partie de ses équipements et ressources proviennent de financements étrangers, notamment de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Malheureusement, ce soutien financier est aujourd’hui compromis en raison des restrictions budgétaires imposées par l’administration américaine, mettant en péril certains projets en cours.
Le Laboratoire d’écologie vectorielle et parasitaire de l’UCAD constitue un maillon essentiel dans la lutte contre le paludisme au Sénégal. Grâce à son expertise en recherche et à son rôle de laboratoire de référence pour le PNLP, il contribue à la mise en place de stratégies efficaces pour réduire la transmission de la maladie. En formant de jeunes chercheurs et en produisant des données scientifiques de qualité, il participe activement aux efforts nationaux et internationaux visant à contrôler et, à terme, éliminer le paludisme.
Cependant, pour que ces avancées se poursuivent, il est indispensable d’accroître les investissements dans la recherche et de garantir un financement stable pour les infrastructures scientifiques. L’éradication du paludisme est un objectif ambitieux, mais avec des moyens adéquats et une collaboration renforcée entre les chercheurs, les autorités sanitaires et les partenaires internationaux, il est possible d’envisager un avenir où cette maladie ne sera plus une menace majeure pour les populations sénégalaises.
infomed